Aurore Turbiau
Pour s'abonner à la lettre d'informations : cliquer ici. Elle est faite à la main en html : donc aucun tracking, les adresses d’envoi sont stockées chez moi mais nulle part ailleurs, et le mail est léger. Chaque lettre contient un lien pour s’abonner (elle peut être partagée) et un lien pour se désabonner.
Accès rapide aux archives :
Dernières lettres envoyées
Janvier 2026 - Questions bisexuelles : où la littérature, où la politique ?
Bonjour !
Alors d’abord, protocole d’usage : je vous souhaite à toustes une très bonne année 2026. J’espère qu’elle sera pour vous pleine de beaux projets, de joies, d’accomplissements divers et variés. On sait déjà qu’elle sera aussi pleine d’anxiété (géo)politique et environnementale (et numérique, et universitaire, et matérielle, cochez vos cases), puisqu’on commence sur les chapeaux de roue : mon meilleur vœu, c’est qu’on arrive à trouver la force de résister à... ÇA, ce monstre global. De toutes les manières possibles, en s’organisant, en prévoyant, en apprenant à faire des choses, en s’entraidant ; mais donc, aussi, en parvenant à faire ce qu’on aime, avec les gens qu’on aime (pipou, oui, mais pragmatique).
Pour les nouvelles : rien de sensationnel, les choses ont continué leur train. J’ai participé à plusieurs colloques vraiment super. J’ai avancé sur de gros dossiers collectifs qui me tiennent énormément à cœur, dont je commencerai à parler au printemps. J’ai fini mon semestre d’enseignement, pendant lequel j’ai surtout eu à faire des introductions aux études de genre en littérature ; je suis un peu lasse (de produire des introductions à répétition), mais c’était une vraie joie renouvelée chaque semaine de retrouver les étudiant-es, de les entendre progresser dans leur propre réflexion, de parler littérature ensemble (j’ai adoré – merci aux étudiant-es d’être là). Côté personnel, je me suis mise à la course à pied, pour compléter le vélo. Le malheur a voulu que j’enchaîne les tendinites : mon kiné suppose que c’est en partie lié au poids de mon sac à dos hebdomadaire (vive la vie turbo). Alors, on y va très petit à petit, mais c’est très bien comme ça.
Le livre est bientôt sous presse, il paraîtra en librairie le 19 mars : édité par les belles Presses Universitaires de Lyon donc, sous le titre Engagées : littératures féministes en France et au Québec (1969-1985). D’ailleurs, je change le titre de la lettre d’informations (il en faut un !), parce qu’autrement tout s’appelait « Engagées » : un peu trop de redondance. Je vous gratifie désormais d’un titre absurde, en lien avec mes nouveaux projets de recherche de fond qui sont, de fait, grandement hors sol (je ris toute seule). Le 19 mars donc, save the date. Le livre paraîtra en même temps que celui de mon amie et collègue Valérie Favre, Virginia Woolf et ses petites sœurs. Un Lieu à soi et sa postérité, en même temps également qu’une réimpression du Chantier littéraire de Monique Wittig, dans la collection « Des deux sexes et autres ». Je vous en redonnerai des nouvelles bientôt.
Quelques publications à signaler
Une parution que j’attendais depuis fort longtemps ! Le numéro coordonné par Nicolas Aude et Danielle Perrot-Corpet : « Penser queer en français : littérature, politique, épistémologie ». Je vous le recommande : l’introduction pose les enjeux en nuances, sans minimiser – au contraire, c’est une grosse partie du sujet – la question d’un écart entre usages littéraires du terme « queer » et définitions politiques, entre dilutions et, au contraire, affirmations militantes et théoriques. Beaucoup d’articles sont passionnants et le numéro d’Acta associé vaut aussi le détour, notamment, à mon avis, pour les recensions de Léo Le Dourion et Pierre Niedergang (pour le reste aussi certainement, je n’ai pas tout lu !).
Quant à moi, j’y ai publié un article sur la notion de bisexualité chez Hélène Cixous. Pourquoi « queer » ? Parce que l’autrice revendique, d’une certaine manière, le terme : sa Méduse est queer, dit-elle. Personnellement, comme féministe engagée sur les questions LGBT/queer justement, j’en doute ou, surtout, je me demande comment c’est vraiment possible : je ne connais pas Cixous comme militante de ces questions, plutôt le contraire. Mais a minima, je me dis qu’il est en effet possible de comprendre quelque chose du côté de la bisexualité, notion qu’elle a développée comme véritable concept. Alors voilà le fruit de mon interrogation, universitaire et théorique ici : à quelles conditions peut-on parler de queerité ? Et au-delà : comment utilise-t-on la notion « queer » en études littéraires ? Quelles histoires convoquent-on, quelles positions ? Est-ce la même chose en politique, en sociologie, en littérature ? En anglais, en français ? C’est un article que je considère être un des plus importants que j’aie écrits pour le moment, à la fois tout court (pour les questions de généalogies du différentialisme qu’il pose) et pour moi de manière plus personnelle (j’ai beaucoup travaillé jusque-là sur le lesbianisme en littérature : me pencher aussi sur la question de la bisexualité m’importait). Ce n’est pas, en revanche, le plus facile à lire : je préviens, il est dense.
 En 2010, à l’occasion de la réédition de son article « Le rire de la Méduse », Hélène Cixous nomme Méduse « [u]ne queer […], la queen des queers. » Cet article propose un examen critique de cette proposition, problématisé à partir du concept de bisexualité travaillé par la même autrice : la notion est l’une de ses grandes « championnes » théoriques. La bisexualité est comprise chez Cixous comme un concept complexe et multiple, à la fois érotique, identitaire, philosophique, politique et littéraire. Il est orienté par des partis pris différentialistes, tout en étant foncièrement antinormatif ; il se place (tout) contre les engagements féministes et lesbiens de son époque, témoignant à sa manière d’une tension qui a constitué une partie de l’histoire des théories « queers ».
En 2010, à l’occasion de la réédition de son article « Le rire de la Méduse », Hélène Cixous nomme Méduse « [u]ne queer […], la queen des queers. » Cet article propose un examen critique de cette proposition, problématisé à partir du concept de bisexualité travaillé par la même autrice : la notion est l’une de ses grandes « championnes » théoriques. La bisexualité est comprise chez Cixous comme un concept complexe et multiple, à la fois érotique, identitaire, philosophique, politique et littéraire. Il est orienté par des partis pris différentialistes, tout en étant foncièrement antinormatif ; il se place (tout) contre les engagements féministes et lesbiens de son époque, témoignant à sa manière d’une tension qui a constitué une partie de l’histoire des théories « queers ».
J’en profite pour signaler la publication, cet été, sur le site de l’association des Ami-es de Monique Wittig, de la transcription numérique du numéro spécial Wittig édité par la revue Vlasta en 1985. C’était un gros travail, qui m’a bien occupée. Il y a notamment cet article d’Hélène Vivienne Wenzel qui évoque la « bisexualité métaphorique » de Cixous au détour d’une phrase, pour lui opposer le lesbianisme radical de Wittig.
👉 À lire sur le site des Études wittigiennes
Parmi les autres publications personnelles, une contribution au volume, que vous avez peut-être vu passer, Théories féministes (dirigé par Camille Froidevaux-Metterie). Somme vraiment magnifique. Ma contribution est très modeste pour le coup, mais elle joue un rôle de revalorisation d’une (du moins trop souvent) « oubliée » : adossé au texte de Julie Abbou et Noémie Marignier sur « Le langage comme espace critique », mon texte présente L’Euguélionne de Louky Bersianik, une œuvre d’importance majeure pour comprendre le féminisme littéraire des années 1970, pionnière pour ce qui concerne la féminisation de la langue française. Je vous copie-colle un bout de ma citation préférée :
 — Pourquoi demander la permission à l’Académie française ? dit l’Euguélionne. [...] Les membres de cette auguste assemblée sont impuissants totalement à changer un iota de cette syntaxe et de cette sémantique. Car les femmes qui composent ladite assemblée, passez-moi l’expression, sont rares comme de la merde de pape et surtout incroyablement effacées. [...] N’attendez plus de permission pour agir, parler et écrire comme vous l’entendez. / Faites des fautes volontairement pour rétablir l’équilibre des sexes. Inventez la forme neutre, assouplissez la grammaire, détournez l’orthographe, retournez la situation à votre avantage, implantez un nouveau style, de nouvelles tournures de phrases, contournez les difficultés, dérogez aux genres littéraires, faites-les sauter tout bonnement.
— Pourquoi demander la permission à l’Académie française ? dit l’Euguélionne. [...] Les membres de cette auguste assemblée sont impuissants totalement à changer un iota de cette syntaxe et de cette sémantique. Car les femmes qui composent ladite assemblée, passez-moi l’expression, sont rares comme de la merde de pape et surtout incroyablement effacées. [...] N’attendez plus de permission pour agir, parler et écrire comme vous l’entendez. / Faites des fautes volontairement pour rétablir l’équilibre des sexes. Inventez la forme neutre, assouplissez la grammaire, détournez l’orthographe, retournez la situation à votre avantage, implantez un nouveau style, de nouvelles tournures de phrases, contournez les difficultés, dérogez aux genres littéraires, faites-les sauter tout bonnement.
Je signale également la parution, dans l’Encyclopædia Universalis, d’un article synthétique de présentation des enjeux « Genre et littérature ». Il est pensé surtout pour les étudiant-es, ou pour les enseignant-es ayant à prendre en charge une introduction, et il est centré sur des références majoritairement francophones (là aussi, pour les besoins de l’enseignement... en français). L’accès est payant, mais dites-moi si vous voulez que je vous envoie le pdf.
👉 À lire sur UniversalisÀ lire (côté essais)
Il se trouve que la bisexualité est un sujet d’actualité : il y a le livre de Camille Teste, Embrasser la bisexualité, tout juste paru, le recueil de traductions depuis l’Argentine Bisexualités féministes. Contre-récits depuis une dissidence située, et le livre de Stéphanie Ouillon. Je n’ai pas encore pu lire les ouvrages en question, mais je recommande de toute façon celui de Stéphanie Ouillon, dont je suivais depuis longtemps « la newsletter bie », toujours très intéressante, notamment parce que justement, elle aborde le sujet très loin d’une manière « métaphorique », avec un prisme plutôt matérialiste dont je me sens proche. Quelle bisexualité radicale ? Sur les traces de la bisexualité politique en France.
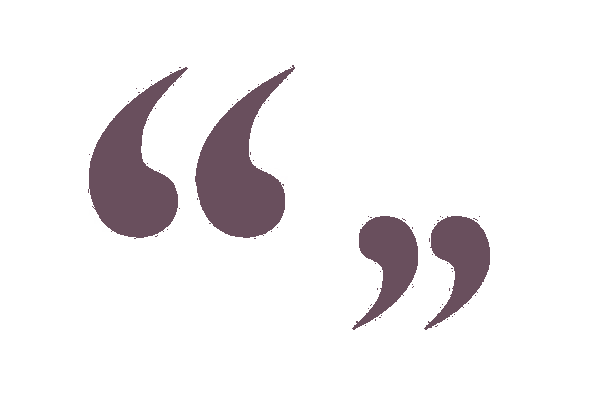 Rarement reconnue et pourtant bien présente : depuis son émergence en tant que catégorie sexuelle, la bisexualité a tour à tour été invoquée, invisibilisée et discréditée dans les discours médicaux, sociaux et politiques. Quelle bisexualité radicale ? explore les traces laissées par les bisexuel·les et la bisexualité dans le contexte politique et militant radical français. Des prémices du mouvement de libération homosexuel à la fin des années 1960, en passant par les luttes féministes et jusqu’à l’émergence du milieu transpédégouine au début des années 2000, cet essai éclaire comment les bisexuel-les et la bisexualité ont habité les mouvements politiques radicaux en France.
Rarement reconnue et pourtant bien présente : depuis son émergence en tant que catégorie sexuelle, la bisexualité a tour à tour été invoquée, invisibilisée et discréditée dans les discours médicaux, sociaux et politiques. Quelle bisexualité radicale ? explore les traces laissées par les bisexuel·les et la bisexualité dans le contexte politique et militant radical français. Des prémices du mouvement de libération homosexuel à la fin des années 1960, en passant par les luttes féministes et jusqu’à l’émergence du milieu transpédégouine au début des années 2000, cet essai éclaire comment les bisexuel-les et la bisexualité ont habité les mouvements politiques radicaux en France.
Le sujet de l’écoféminisme (et associés) est brûlant aussi ; proche de mes intérêts de recherche immédiats, je signale la parution du volume de Laure Saincotille, Écoféminismes. Savoirs contre-nature, qui suit de peu celle du collectif dirigé par Pauline Launay, Françoise d’Eaubonne. Causes communes (le second tome paraîtra bientôt). Il y aussi, plutôt du côté philosophie, Zones. Terre, sexe et science-fiction, de Jeanne Ételain. Celui-là, je ne l’ai pas lu encore, mais j’ai grand hâte. En vraiment lu et certainement recommandable, je citerais aussi le Remember Fessenheim, de David Dufresne, une enquête sur l’engagement politique de sa grand-mère – c’est connu maintenant – Françoise d’Eaubonne. Le livre est touchant, l’enquête sérieuse et vraiment intéressante, pour connaître d’Eaubonne c’est parfait, pour trouver du courage politique et de l’« inspiration », encore mieux. J’ai particulièrement aimé l’attention portée – c’est signé – à l’action politique de terrain, à ses enjeux et contradictions, notamment après la période que tout le monde connaît le mieux, celle des années 1970. Un malus pour la citation sans recul d’une certaine MJB un peu trop violemment transphobe par contre, mais cela se justifie pour des raisons biographiques.
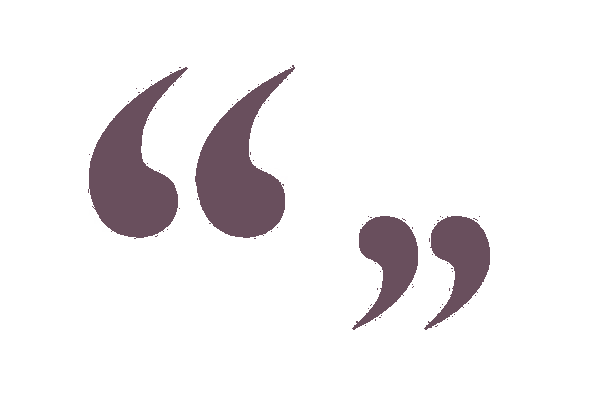 « Cours ma sœur, le vieux monde mâle explose derrière toi... » [...] C’était une activiste exceptionnelle, en lutte partout, dans les rues et avec sa machine à écrire [...] l’auteur cite les notes blanches des services, les journaux intimes inédits de sa grand-mère, les interviews renversantes à Apostrophes, il va sur le terrain, raconte, échange, s’interroge, révèle et rend ainsi vie et force à l’inoubliable combattante.
« Cours ma sœur, le vieux monde mâle explose derrière toi... » [...] C’était une activiste exceptionnelle, en lutte partout, dans les rues et avec sa machine à écrire [...] l’auteur cite les notes blanches des services, les journaux intimes inédits de sa grand-mère, les interviews renversantes à Apostrophes, il va sur le terrain, raconte, échange, s’interroge, révèle et rend ainsi vie et force à l’inoubliable combattante.
À lire (côté univ)
Parmi les parutions universitaires, il y a l’important numéro dirigé par Jean-Christophe Abramovici, Marion Bonneau et Carla Robison, « Écrire, prescrire : l’invention du corps féminin » dans Littérature (n° 219), également disponible sur Cairn.
Il y a aussi le numéro 54 de la revue Études littéraires, dirigé par Nicolas Duriau et Lucie Nizard, « Non-dit(s) du genre et de la sexualité dans le roman d’expression française au XIXe siècle », à lire sur la plateforme Érudit.
Je signale aussi la nouvelle revue Les Mains invisibles, dirigée par Alix Kazubek et Victoria Rimbert, qui est prometteuse. Elle a son propre site, Les Mains invisibles.
Et pour finir, plutôt du côté de la critique littéraire, je voudrais mentionner le dossier consacré à Ursula Le Guin, « Ursula K. Le Guin : une écrivaine pour le XXIe siècle ».
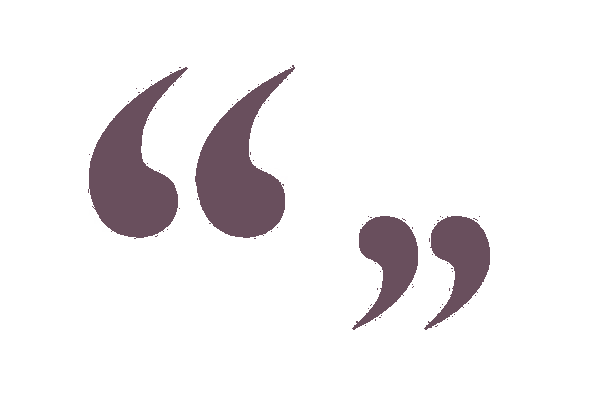 Au sein de la science-fiction et de la fantasy, comme dans la littérature générale, nombre d’écrivain(e)s revendiquent aujourd’hui son influence. La parution de Searoad, dernier de ses romans non traduit en français, est l’occasion de faire le point sur une œuvre aux multiples facettes, terriblement actuelles.
Au sein de la science-fiction et de la fantasy, comme dans la littérature générale, nombre d’écrivain(e)s revendiquent aujourd’hui son influence. La parution de Searoad, dernier de ses romans non traduit en français, est l’occasion de faire le point sur une œuvre aux multiples facettes, terriblement actuelles.
À suivre
Je vais prêcher pour ma paroisse, mais parmi les séminaires qu’il faut absolument suivre en 2026, se trouve le séminaire pour un chantier littéraire (wittigien). Il se tient une fois par mois, principalement au format atelier (mais aussi conférences). La prochaine séance est le mercredi 14 janvier, à 18h (heure de Paris), toujours intégralement en visio. Nous avons passé du temps, cet été, à mettre au propre les séance de la saison précédente : vous pouvez juger sur pièce, c’est un séminaire où il se passe des choses, où l’on lit Wittig vraiment en détails.
👉 Vous pouvez parcourir les notes de l’année passée
👉 Pour le calendrier et le lien de connexion, c’est ici
À suivre, mais plutôt comme un maxi tuto cette fois, le Guide pratique d’artisanat numérique à l’Université, tout juste publié par Christophe Masutti. « Il s’adresse aux étudiants et enseignants-chercheurs qui souhaitent progresser dans la maîtrise d’une chaîne de production numérique, de la prise de notes à la production d’un cours, d’un article, d’un rapport, d’une thèse, ou d’un livre. » Le mot-clé est bien artisanat : ça se bricole à la main. C’est vrai, à la main, c’est plus dur, c’est un apprentissage : mais ça vaut mieux que la fausse magie de Microsoft et Google (vous avez vu l’actualité des États-Unis ?). Le programme, je le cite depuis le menu qui se déroule chapitre par chapitre : Introduction : se libérer ; Changer le système ; À la recherche de la chaîne de production ; Écrire en Markdown ; Un Terminal pour piloter votre système ; Convertir avec Pandoc ; Choisir son atelier d’écriture ; Zettlr, Pandoc, Zotero ; Et les autres logiciels ; La production de PDF ; Synchronisation et stockage distant ; Utilitaires et services ; Zettlr : astuces ; Zotero : les notes.
👉 C’est à découvrir directement sur le site frama du guide.
Voilà ! Rien de plus pour le moment, c’est déjà beaucoup. La prochaine fois, je parle du livre et probablement d’au moins un des autres gros dossiers de recherche en cours, celui sur les grands corpus. À la prochaine !
Aurore.
Septembre 2025 - Le féminisme et “la théorie”
Bonjour !
J'avais prévenu que cette lettre d'informations ne serait pas exactement spammante : nous voilà cinq mois après.
Ici, c’est jour de manif, donc. Rentrée en fanfare même si, enfin, on aimerait mieux s'en passer. En petit décalage de ton, j'envoie quand même.
Pour le reste : c'est la rentrée, la préparation des cours, la reprise des directions d'ouvrages, la mise à jour des dossiers de recherche. Le livre est parti en épreuves, on est en train de choisir sa couverture, j'en donnerai bientôt des nouvelles. Ma résolution de rentrée : essayer de moins flinguer ma santé dans cette vie « turbo » d'entre plusieurs villes, en ralentissant un peu (comme je peux) (et cela implique notamment de faire le plus possible de promenades à vélo sur les berges du Doubs).
Quelques publications à signaler
Second épisode de la série commencée au printemps, sur le carnet, « Le féminisme est-il une théorie littéraire ? » : cette fois j'essaie de dire que ce n'est peut-être pas exactement cela, mais qu'en tout cas, il peut en parler. Ce second billet cite particulièrement des idées soulevées par Donna Haraway. Il est bien sûr question de théorie littéraire, mais aussi de singes, de géocritique, de cinéma, de mathématiques. (Sachez que je suis très fière de mon choix d'illustration, bien qu'il soit discutable).
Quatre propositions, après les trois premières, avant les six dernières :
- le féminisme est une situation théorique qui situe à son tour – identifie, caractérise et responsabilise – “la théorie” ;
- le féminisme oriente la théorie ;
- le féminisme interroge la théorie comme institution ;
- le féminisme impose une politique de la théorie.
Parmi les autres publications personnelles, une scientifique (en anglais) : dans Intertexts, revue comparatiste, pour un numéro dirigé par Pierre Zoberman intitulé « (Re-en)gendering Intertextuality: Queer Pasts and Futures ».
« About a lesbian “memory of texts”: “lesbian literature” as a problematic and (re-en)gendering category ». Le point de départ est pris, ici, dans l'idée que pour définir ce que peut être une histoire « lesbienne » de la littérature, on est obligée de prendre en considération l'importance centrale d'un critère d'intertextualité. Parce que, d'un côté, il faut lutter contre l'effet « palimpseste » identité par Audrey Lasserre, qui fait que l'histoire littéraire des femmes est perpétuellement réécrite et réoubliée. Parce qu'en outre, il y a une minorisation spécifiquement liée au sujet « minoritaire », homosexuel. Comme le dit Wittig, ces écrivaines du lesbianisme arrivent sur une scène littéraire qui programme multiplement leur effacement. L'une de leurs ressources est bien celle de l'intertextualité : les écrivaines se citent, s'inscrivent dans une histoire nommée, identifiée et théorisée (restons dans le thème du jour) comme lesbienne, pour pouvoir être à leur tour identifiées comme telles. C'est donc une « mémoire des textes » particulière qu'on peut constater à l'époque des années 1970-1980. Mais cette démarche est aussi retorse, lorsqu'on la réplique du côté du geste de recherche. Paradoxalement, plus on donne d'importance au critère de l'intertextualité, plus on marginalise celles qui font moins partie des réseaux, disons, majoritaires parmi les minoritaires. Celles qui ne sont pas citées disparaissent.
Une des idées que j’aime bien, dans cet article, est celle qui rapproche l'intertextualité lesbienne d'une sorte de placard : parce que les références ne sont pas toujours limpides pour un public non averti, parce qu'il y a à la fois mise en évidence et dissimulation.
 [...] Secrecy continues to be the key to survival since it preserves and protects by controlling what can be filtered out. Intertextuality may thus be understood as a textual modality of the closet: a method for performance, for showing and hiding, for building both precarious and significant links, partly made obvious for those who know and care about lesbian history, partly made invisible and insignificant for the others. [...]
[...] Secrecy continues to be the key to survival since it preserves and protects by controlling what can be filtered out. Intertextuality may thus be understood as a textual modality of the closet: a method for performance, for showing and hiding, for building both precarious and significant links, partly made obvious for those who know and care about lesbian history, partly made invisible and insignificant for the others. [...]
Sur des thématiques à la fois féministes et lesbiennes toujours, je signale aussi une petite recension de l'ouvrage « Le Mouvement féministe est un complot lesbien ». Une anthologie (1969-1974, USA), paru en mai dernier aux Rotolux Press. Je vous spoile son dernier paragraphe, qui résume le (grand) intérêt que j'y vois :
 Bel objet, le livre est donc, aussi, signe d’un féminisme et d’un lesbianisme résolument matérialistes. Il souligne que l’histoire des pensées et luttes féministes et lesbiennes est continue, y compris dans ses renouvellements et dans ses conflits : elle est contemporaine et toujours vive de ses propres élans, ruptures et contradictions. L’anthologie répond ainsi, concrètement, à l’appel des militantes lesbiennes des années 1970, « à la recherche, à l’archivage et à la diffusion », comme bases fondamentales de tout travail politique. Elle n’est pas seulement le témoin d’un moment historique – souvent oublié, parfois mythologisé au contraire –, elle est aussi un appel à la reconnaissance du coude-à-coude des générations et des courants qui font les combats et les débats du jour, pour comprendre ce qui reste à faire et à écrire aujourd’hui.
Bel objet, le livre est donc, aussi, signe d’un féminisme et d’un lesbianisme résolument matérialistes. Il souligne que l’histoire des pensées et luttes féministes et lesbiennes est continue, y compris dans ses renouvellements et dans ses conflits : elle est contemporaine et toujours vive de ses propres élans, ruptures et contradictions. L’anthologie répond ainsi, concrètement, à l’appel des militantes lesbiennes des années 1970, « à la recherche, à l’archivage et à la diffusion », comme bases fondamentales de tout travail politique. Elle n’est pas seulement le témoin d’un moment historique – souvent oublié, parfois mythologisé au contraire –, elle est aussi un appel à la reconnaissance du coude-à-coude des générations et des courants qui font les combats et les débats du jour, pour comprendre ce qui reste à faire et à écrire aujourd’hui.
Je signale aussi en passant qu'en juin, Écrire à l'encre violette. Littératures lesbiennes en France de 1900 à nos jours est reparu en poche, trois ans donc après la première publication. Nous avons apporté quelques petites modifications au texte ici ou là, mais surtout, le volume est désormais plus abordable : il est en vente à 13 €. Comme pour la première édition, 80 % des droits d'auteur-ices sont reversés à la LIG, fonds de dotation féministe et lesbien (l'édition brochée nous a déjà permis de verser 2 252 € à l'association).
👉 Voir sur la page du Cavalier BleuÀ suivre / à lire / à voir
Parmi les autres parutions à signaler, dans le même registre : « Pour une histoire des écrits queers », édité par Guy Chevalley, Nathalie Garbely et Edward Mandry sur Le Courrier.
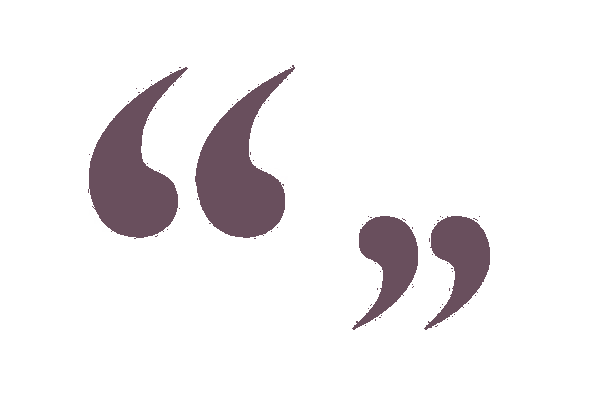 Les œuvres et auteur·ices LGBTQIA+ de Suisse romande sont peu visibles, et même invisibles avant l’an 2000. Une équipe de recherche s’est donné pour but de les sortir de l’ombre. Elle explique ici la genèse du projet, avec la volonté de « faire archive » en chemin. Une investigation portée par la petite maison romande Paulette Editrice.
Les œuvres et auteur·ices LGBTQIA+ de Suisse romande sont peu visibles, et même invisibles avant l’an 2000. Une équipe de recherche s’est donné pour but de les sortir de l’ombre. Elle explique ici la genèse du projet, avec la volonté de « faire archive » en chemin. Une investigation portée par la petite maison romande Paulette Editrice.
Également la traduction de Joanna Russ, Comment torpiller l'écriture des femmes, par Cécile Hermelin et avec une préface d'Élisabeth Lebovici.
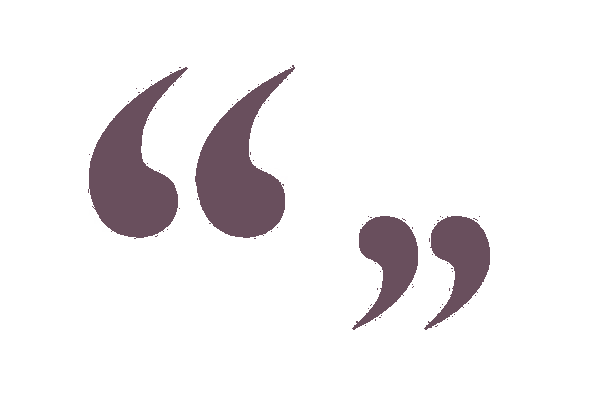 Dans ce classique de la critique féministe publié en 1983 aux États-Unis et traduit pour la première fois en français, Joanna Russ dresse un panorama acéré des techniques d’empêchement, d’effacement et de dénigrement qui s’abattent depuis des siècles sur les femmes qui osent prendre la plume. [...] En décortiquant les stratagèmes du sexisme ordinaire dans le monde des lettres, Russ signe un formidable anti-manuel de silenciation des femmes autrices, qui n’a perdu ni de son actualité ni de sa force critique.
Dans ce classique de la critique féministe publié en 1983 aux États-Unis et traduit pour la première fois en français, Joanna Russ dresse un panorama acéré des techniques d’empêchement, d’effacement et de dénigrement qui s’abattent depuis des siècles sur les femmes qui osent prendre la plume. [...] En décortiquant les stratagèmes du sexisme ordinaire dans le monde des lettres, Russ signe un formidable anti-manuel de silenciation des femmes autrices, qui n’a perdu ni de son actualité ni de sa force critique.
Autre registre ! Paru en avril dernier, un billet d'Audrey Safa et Clothilde Saunier sur Zettlr, « À la recherche d'un logiciel libre pour l'écriture ». Vous savez que c'est ma came. L'article est très clair.
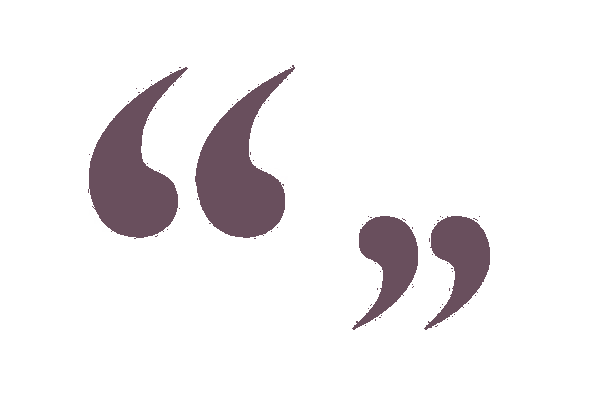 Lors de nos mémoires, la centaine de pages et notes de bas de page liées à Zotero ont rendu la fin de l’écriture et de la mise en page extrêmement laborieuse. Chaque modification de références ou de notes de bas de page faisait alors buguer LibreOffice et/ou Zotero. Après cette expérience ponctuée de sueurs froides, changer d’éditeur de texte semblait nécessaire pour la thèse. [...] de fait, dès qu’on commence notre doctorat, on entend très rapidement des mésaventures de doctorant·es en fin de thèse qui passent des nuits blanches à rectifier leur manuscrit sur Word ou LibreOffice, enchaînant bugs, modifications aléatoires de mises en page et autres références manquantes. [...]
Lors de nos mémoires, la centaine de pages et notes de bas de page liées à Zotero ont rendu la fin de l’écriture et de la mise en page extrêmement laborieuse. Chaque modification de références ou de notes de bas de page faisait alors buguer LibreOffice et/ou Zotero. Après cette expérience ponctuée de sueurs froides, changer d’éditeur de texte semblait nécessaire pour la thèse. [...] de fait, dès qu’on commence notre doctorat, on entend très rapidement des mésaventures de doctorant·es en fin de thèse qui passent des nuits blanches à rectifier leur manuscrit sur Word ou LibreOffice, enchaînant bugs, modifications aléatoires de mises en page et autres références manquantes. [...]
Et enfin, sur recommandation de mon amie-collègue Suzel Meyer, je suggère de lire ce billet (en anglais) de Brandon Taylor sur ce que cela signifie de « relire » quelqu'un-e (un-e étudiant-e, un-e ami-e, un-e collègue...). Il parle d'écriture créative, cela s'applique aussi à l'écriture scientifique. De mon côté, j'aime beaucoup relire et je crois que je tombe d'accord avec beaucoup de ses constats (ou espoirs !)
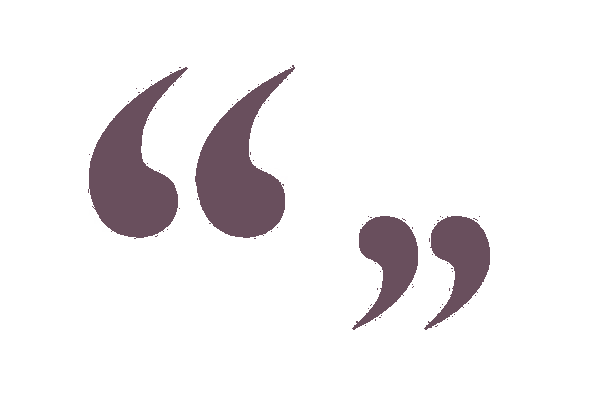 When someone brings a novel to a discussion group or a crit group or workshop or feedback group, they are sometimes under the delusion that what they are getting is a simulation of a wild-type encounter. You should stop thinking this. A feedback group is the most extremely artificial encounter your work will ever experience. [...] These people are writers, first of all, and second of all, they are writers who are under a social contract to offer you feedback. So, no, it’s not like a random stranger at all and should not be governed by those expectations. I think it’s insane that people will bring twenty pages from a book and show it to you and be like, “What do you think?”
When someone brings a novel to a discussion group or a crit group or workshop or feedback group, they are sometimes under the delusion that what they are getting is a simulation of a wild-type encounter. You should stop thinking this. A feedback group is the most extremely artificial encounter your work will ever experience. [...] These people are writers, first of all, and second of all, they are writers who are under a social contract to offer you feedback. So, no, it’s not like a random stranger at all and should not be governed by those expectations. I think it’s insane that people will bring twenty pages from a book and show it to you and be like, “What do you think?”
Divers
Un appel encore en cours (jusqu'au 5 octobre) pour un colloque à Liège : « Inventer en revue. Expérimentations esthétiques et éditoriales dans les revues de poésie francophone, 1970-2000 ». L'appel est notamment diffusé sur fabula.
Et un autre, pour une publication sous la direction de Cornelia Möser et Maria Teresa Mhereb : « Traductologie féministe ? Histoire et actualité d’un courant critique ». Je ne trouve pas l'appel en ligne, je l'ai reçu via la liste EFiGiES.
Voilà ! À la prochaine.
Aurore.